« … la science-fiction va se ramifiant et s’étendant si vite qu’il faut déjà, à l’intérieur de ce contenant génétique, créer des sous-catégories. » Boris Vian
|
Introduction Comme nous l’avons vu précédemment, il n’existe pas de véritable définition consensuelle solide de la science-fiction. Etant à l'origine une littérature d’évasion imaginative, la forme de chacun de ses récits, non régie par un code de structure propre à ce genre, s’évade vers une direction imprévisible, au service du (ou des) thème(s) abordé par l’auteur et soumise à la volonté de dépaysement de celui-ci. Ainsi, chaque auteur amène son récit où il le désire et sans aucune limite -contrainte issue de la raison. Cette dernière, en effet, est au service de l’imagination à fin de justification. Cependant, comme dans tout acte créatif, il est manifeste de constater quelques courants récurrents sous l’appellation science-fiction. Ceux-ci sont issus d’une poussée éditoriale mercantile, de l’influence de certains auteurs sur d’autres, de la volonté de puiser plus en profondeur dans les thèmes abordés ou d’explorer plus en avant tous les possibles d’un monde créé dans un récit précédent. A ces emprunts et autres inspirations s’ajoute un jeu où le récit de science-fiction joue en réintroduisant certains objets ou concepts récurrents. Ainsi s’instaure une sorte de connivence entre le lecteur/spectateur et le récit, c’est à dire entre le lecteur/spectateur et la science-fiction, amenant ce que certains qualifieront d’élitisme, d’autres de sectarisme. Cette connivence est souvent assimilée à de l’ostracisme. En effet, la science-fiction se nourrit souvent de la science-fiction et certains nouveaux lecteurs/spectateurs peuvent se sentir ‘largués’ devant un débit d’explications scientifico-science-fictionesque digne d’un épisode de la série télévisée Urgence. Cette réaction peut être également observée devant le manque d’explication sur certains faits ou phénomènes à importance narratif capitale, non ou sous-expliqués parce que sensés être assimilés par les lecteurs, spectateurs ou auditeurs de science-fiction. Ce phénomène peut être identique à celui ayant lieu en informatique, à travers la connaissance hardware ou la dissimulation de ‘bonus’ dans des produits informatiques -notamment pour certains DVD du commerce- pourtant achetés par un public hétéroclite et non exclusivement informaticien. Où commence la connivence ? Où commence le sous-genre ? Une fois de plus la science-fiction joue de sa forme et brouille les cartes. Tout d’abord, il est nécessaire de différencier la science-fiction du fantastique : deux genres souvent couplés utilisant des procédés proches, voire identiques, et tout deux issus ce que l’on pourrait qualifier de narration imaginative. Science-fiction et fantastique « La science-fiction, ce sont des mythes modernes – le fantastique ce sont de très vieux mythes. » Pierre Kast (dans Cinéma Science-fiction, 1978, Ed. Livre de poche, p 179) à venirSous-genre de la Science-fiction : A la recherche d’une structuration de la Science-fiction « Pour toute question complexe, il y a une réponse simple. Et c’est une erreur. » H. L. Mencken Nombreuses ont été les tentatives de définir les limites précises de la science-fiction. Cependant, comme le souligne Klein, chaque fois que l’on a tenté d’enfermer la science-fiction dans une cage de règles, il y toujours eu un auteur pour en repousser les murs. La structure de la science-fiction semble presque organique tant elle est changeante, évolutive ; tant elle se défend contre toute agression rationnelle. Ainsi Vian rappelle, dans Cinéma science-fiction, une première tentative, en 1946, de Groff Conklin de classer les récits de science-fiction. Pour Conklin, la science-fiction était alors divisible en sept parties :
Cette classification repose sur une sélection des œuvres de science-fiction à partir de sept enveloppes générales s’intéressant à l’objet nouveau introduit par chaque récit. Ainsi est-t-il facile de classer La Guerre des Mondes (1???, Wells), avec ses extraterrestres envahisseurs, dans la sixième catégorie. Par contre, Contact (1997, Robert Zemeckis) serait-il classé dans la sixième partie puisque les plans d’une machine-véhicule ont été envoyés par des extra-terrestres, dans la septième partie suite à l’utilisation du véhicule par l’héroïne, ou dans la troisième partie puisque le film, comme le roman de Carl Sagan dont il est issu, ne cesse de s’interroger sur la science, la religion et l’accessibilité de l’homme à certaines connaissances ou certains concepts ? Il est vrai qu’en 50 ans la science-fiction a pu évoluer et rendre ainsi la classification caduque, mais une lecture de récits antérieurs à 1946 montrent également la superficialité de cette méthode de classement. Ainsi, la pièce de théâtre écrite par Karel Capek en 1920 où fut introduit pour la première fois le mot ‘robot’ fut-elle classée dans les inventions dangereuses puisque pouvant détrôner l’homme ? Peut-on classer un tel récit dans les inventions alors que ces robots n’ont d’utilité que de cristalliser le sujet principal de la pièce : la peur de l’homme de se mener soi-même à sa perte. Cette ambition prométhéenne déjà si bien illustrée par Shelley dans Frankenstein, lui même classé à contre-cœur dans ‘les inventions’ ou ‘la superscience’, termes aussi vague que possible. Si cette classification est aujourd’hui totalement obsolète, elle pose néanmoins le doigt sur quelques thèmes d’une science-fiction que l’on pourrait qualifier aujourd’hui de classique voire d’académique. On peut en effet regrouper des parties entre elles :
Cette nouvelle structuration reste bien évidemment incomplète mais permet de poser la question : comment aborder la science-fiction pour la classer ? Faut-il sélectionner les œuvres à partir de leur forme ? On a vu que celle-ci était tellement souple et sans limite que cela paraît impossible. Faut-il sélectionner à partir des thèmes ? On a également vu le jeu de certains auteurs à brouiller les pistes. A l’image d’Outland, qui peut être considéré comme un western, beaucoup de récits empiètent dans les autres genres littéraires, cinématographiques ou autres. Ainsi les westerns, les récits d’aventure, d’action, le policier, le suspense, etc seraient englobés par la science-fiction. Le problème semble difficile à résoudre. Dans son introduction à la science-fictionPQR, Yvon Allard nous présente la classification du critique américain Kendell Crossen, qui cherche à contourner ce problème. Pour lui, la science-fiction de divise en trois parties :
Cette classification couvre en effet un spectre plus large des récits de science-fiction, mais reste bien trop évasive. De plus, il est facile de voir la method story comme une sorte d’extension à ce que l’on appelle la ‘hard science’ ou la sociological story -présentée par Allard comme « portant son intérêt sur l’état psychologique ou social du monde actuel face à l’avenir ou d’un futur imaginé prospectivement »- comme une branche de la fiction spéculative. La romantic story pouvant être le fourre-tout des récits restants si embarrassants. Structurer un genre aussi vaste et divers que la science-fiction en seulement trois sous-genres à l’énoncé aussi évasif que le terme initial et certains récits -ce que Allard fait remarquer avec Fondation d’Asimov- s’insérant dans ces trois parties simultanément, n’est pas à proprement parler une avancée. Cependant, il est intéressant de constater que dans cette tentative de classification, on ne se base plus exclusivement sur : soit le fond, soit la forme. Alors que la classification de Conklin jugeait les films à partir de leur forme, on constate que la romantic story ne se jugerait que sur la forme, la method story s’axerait quasi-principalement sur le fond, et la sociological story développerait à la fois fond et forme. Cet aspect me paraît fondamental dans la recherche d’une structure : tous les récits de science-fictions ne doivent pas être comparés sur de mêmes éléments. Certains se signeront d’un sous-genre par leur forme, sans se soucier -ou plus précisément en se souciant moins- de leur fond, alors que d’autres seront signés du même sous-genre par leur fond, sans se soucier -en se souciant moins- de leur forme. Ainsi, par exemple, un récit à la forme de fantasy mais que l’on sait se situer sur Terre après un cataclysme sera considéré malgré tout comme un film post-apocalyptique. En effet, même si la forme est strictement identique, le simple fait de savoir que l’on est sur une Terre post-cataclysmique -même si le public ne l’apprend qu’à la fin du récit- change totalement la préhension du récit. Un jeu de rôle, Shadowrun, présente un univers profondément ancré dans le cyberpunk et où s’y ajoute la présence d’elfes ou de magiciens. Ces derniers n’apportent cependant pas au final le caractère épique de la fantasy et laissent le jeu se dérouler dans un esprit totalement cyberpunk. Un autre exemple sera celui de La Planète des Singes, (19??, Shaftner) : le film, plongé dans un monde où le singe et l’homme ont ‘échangé’ leurs rôles, se développe comme une histoire de fantasy. La présence d’un vaisseau spatial et le fait que le héros soit un astronaute venant d’une autre planète oriente le film vers de la science fantasy. Mais quand à la fin on apprend qu’il est en fait sur Terre, le film dévoile son appartenance au genre post-apocalyptique. Avant cette découverte, le spectateur voit un homme se débattre dans un lointain autre, et observe une société d’être humanoïdes ressemblant à des singes terrestres. Le film critique cette société simienne à travers les yeux du héros. Jusqu’à la fin, le spectateur décrypte le film par une critique de sa propre société, comme dans tout récit de ce type. Mais après la révélation, le film réoriente ces critiques en les laissant aux singes, tout en empirant celle de la société ‘humaine’. Ce basculement final transcende le contenu et le message de la totalité du film ; lui donnant toute son importance, c’est donc bien ce court passage qui définit le genre du film. Un dernier exemple, Conan le barbare (19??, ??????), est l’exemple type du ‘sword and sorcery’. Le film ne brille aucunement par son fond particulièrement creux, mais par sa forme, cohérente du début jusqu’à la fin, description d’un monde de type médiéval baigné de magie. Ici, le fond du film est totalement au service du réalisme du monde présenté. Sa quasi-inexistence vient de sa redondance du fond, aux ficelles narratives recopiées sur celles du conte, vis à vis de la forme qui éveille déjà au spectateur cet univers. Cette absence de ‘surprise’ entraîne un classement dans le sword and sorcery par et uniquement par la forme. Quiconque ayant la volonté de structurer la science-fiction se trouve face à l’existence de dénominations profondément commerciales et révélant la pratique éditoriale. Un ouvrage se vent bien ; l’éditeur le qualifie -plus ou moins arbitrairement- d’un genre, par exemple de ‘heroic fantasy’, et demande de l’heroic fantasy à ses auteurs. Ensuite, l’éditeur de dire au public : « regardez, c’est comme l’autre livre/film, c’est tout aussi bien » et au public de vouloir se plonger à nouveau dans ce monde fictif où l’avait amené le premier récit. Ces pratiques éditoriales (la plupart des évolutions dans la science-fiction ayant lieu dans la littérature) ont participé à la création de sous-genre par le volume d’ouvrages de qualité diverse ainsi créé. Cette position éditoriale enclenchée par Gernsback a entraîné la réutilisation d’objets dans plusieurs récits. Se sont alors peu à peu créés mais également étoffés des mondes et des univers fictifs propres à ces sous-genres. Ainsi, par exemple, les lasers tueurs et l’hyperespace pour le space opera, les elfes, orques, ou autres créatures présentes dans la fantasy ou les implants technologiques au cerveau dans le cyberpunk deviennent des éléments pratiquement indispensables pour que le récit appartienne au sous-genre. Cependant, la comparaison des récits de science-fiction ne se basant pas sur de mêmes repères (fond, forme, ou les deux), ces différents univers vont à nouveau changer, évoluer, être à la fois explorés et éprouvés sous la plume de ces si facétieux auteurs. Certains, même, n’hésiteront évidemment pas à les utiliser à contre-sens de leur utilisation habituelle. Néanmoins, tous ces objets récurrents, constitutifs de ces univers, resteront une référence pour le public pour qui va se créer un univers-étalon de chaque sous-genre. Ces univers-étalons seraient les codes caractéristiques de ces sous-genres si les auteurs ne s’amusaient pas autant à jouer avec ces codes. Peut-on encore parler de space opera lorsqu’un auteur remplace les vaisseaux spatiaux par de grandes baleines ou quand le héros ne voyage plus dans des vaisseaux mais par un système de portes menant immédiatement d’un endroit à l’autre de l’univers ? La différence entre les codes classiques de détermination de genre et ces univers-étalons réside dans le fait que ces univers ne sont pas exclusifs et qu’il peut suffire de n’évoquer qu’un seul élément, de forme ou de fond, pour définir le récit. Le chevauchement de ces univers est fréquent dans un même récit et les auteurs jouent en plaçant leur récit dans un premier univers-étalon en introduisant quelques éléments, générant ainsi pour le public une référence implicite, le conforte en réintroduisant ensuite d’autres éléments du même univers-étalon, puis créent un effet narratif en introduisant un élément majeur d’un autre univers-étalon. Le renversement final de La Planète des Singes en est un exemple typique. Outland ou Los Angeles 2013 (19??, Carpenter) sont un exemple de mélange de codes du western et d’univers-étalon de science-fiction classique pour le premier et de dystopie pour le second. La recherche de structure de la science-fiction passe donc par une étude judicieuse permettant, parmi toutes les pistes offertes par l’auteur, de reconnaître le ou les éléments majeurs de chaque récit afin d’en déterminer l’univers-étalon et, donc, le sous-genre affilié. Ces éléments majeurs doivent être ceux qui donnent tout son sens à l’ensemble du récit, et non une simple ‘porte’ permettant au lecteur de piocher un univers-étalon de simple situation du récit. Ainsi, l’élément majeur de la série des quatre films Alien (19 ??, Scott ; 19 ??, Cameron ; 19 ??, Fincher ; 19 ??, Jeunet) n’est pas le vaisseau spatial en direction de la terre ou la visite d’autres planète. Ceux-ci appellent au spectateur un univers-étalon de space opera, permettant, sans qu’aucune justification ne soit donnée, d’expliquer la verticalité des personnages dans les vaisseaux par d’hypothétiques moteurs d’antigravité, l’utilisation de l’hibernation sans avoir à en expliquer le principe, etc. Cependant, l’élément principal est cette créature, l’‘alien’ -l’étranger-, et l’attitude des personnages vis-à-vis d’elle, symbole psychanalytique lourd traînant avec elle le thème classique de science-fiction de la préhension de l’inconnu par l’homme (ce à quoi vont s’ajouter d’autres thèmes extrêmement forts, mais tous drainés par cette créature). Ces univers-étalons sont également à l’origine de ce ‘sectarisme’ de la science-fiction. Plus on est fan, plus on a lu de livres, vu de films, plus on est imprégné de la science-fiction et plus nos univers-étalons sont étoffés. Pour reprendre les termes de Laurent Genefort, la partie « verticale » de la science-fiction enrichit les univers-étalons et la partie « horizontale » les utilise, tels des tubes de peintures dans la construction d’un tableau : certains préférant les tonalités monochromes des sous-genres et courants bien définis, alors que d’autres préférant jouer sur les couleurs en les harmonisant tout en piochant dans plusieurs tubes. Les personnes se sentant perdus dans certains récit, outre ceux qui n’ont pas le goût de la littérature d’imaginaire, n’ont généralement pas d’univers-étalons étoffés. Cette connivence auteur-public propre à la science-fiction issue du jeu de correspondances est attisée par la présentation d’éléments décrits de façon inhabituelle mais que le fan saura reconnaître (ce n’est pas du vert, mais un mélange de bleu et de jaune). Le problème de structuration et le jeu des codes par une manipulation d’univers-étalons vient à mon avis de ce que Klein qualifie d’‘illégitimité’. Ce phénomène d’illégitimité trouve résonance à travers le concept d’Internet. Il y a quelques années, tout le monde louait aveuglément le progrès que constituait ce réseau informatique. Le terme de ‘révolution intellectuelle’ pouvait être lancé : tout était accessible à tout le monde, gratuitement. C’est ce dernier aspect qui posa problème au système commercial de nos sociétés en enfreignant l’une de ses règles de base : les droits d’auteurs, absente dans la pensée scientifique à l’origine du réseau. Aujourd’hui, Internet a perdu contre le commerce à travers le symbole du procès d’un site de téléchargement musical. Cette illégitimité informatique de -finalement- courte durée qui survit aujourd’hui illégalement, démontre parfaitement la rigidité et le côté réactionnaire des structures commerciales devant les utopies intellectuelles -qualifiées généralement de peu sérieuses par les même personnes qui qualifient la science-fiction de peu sérieuse. Et c’est devant cette même rigidité que la science-fiction résiste par un paradoxe commercial: sa vie est issue de cette créativité tous azimuts génératrice de succès, donc de profits, que les éditeurs ou producteurs, cherchent à brider pour cause de recherche de profits. La science-fiction, comme l’informatique, est menée par de jeunes individus ou des personnes ayant gardé ce que l’on appelle communément un ‘esprit jeune’. Ce n’est pas par une coïncidence que la science-fiction et l’informatique ont la même ‘cible’ des jeunes de 15 à 25 ansZZZ. Toutes deux ont été inventées puis développées par de jeunes adultes. Cet ‘illégitimité adolescente’ est propre à l’insouciance des jeunes individus, la vision encore ouverte sur l’avenir, leur propre avenir n’étant pas encore délimité ni tracé. Il me paraît évident que ce besoin de limites à franchir, de censure politique comme morale à travers la dénonciation des tabous, est directement issu de cette étape de la croissance adolescente consistant à rejeter ce qui vient des parents. L’enfant finit par avoir besoin de manifester sa propre personnalité et, pour cela, sa solution est bien souvent le rejet de la parole parentale. Or, peut-il y avoir de meilleure méthode à affirmer son ‘soi’ que de s’immerger dans un monde extérieur, plus proche de notre sensibilité que cette pesante réalité dominée par l’autorité parentale ? Peut-être la science-fiction cristallise autour d’elle des personnalités ayant consciemment ou pas le sentiment d’incapacité à s’affirmer dans le monde réel. Peut-être la science-fiction n’est qu’un échappatoire de cette pulsion humaine de curiosité aigu enclenchée dès la naissance et frustrée à l’adolescence par une représentation parentale posée comme ayant les ‘clés’ du monde et obligeant l’individu à canaliser sa pulsion dans des mondes imaginaires. Quoi qu’il en soit, le rejet du système économique en se laissant capter par des terminologies peut s’expliquer par cette pulsion humaine d’affirmation de soi, par le rejet des contraintes. Un exemple illustre ceci parfaitement : dans le film Contact, un dialogue a lieu entre deux personnages du film : « - J’aimerais bien que le monde soit l’endroit où la justice est le principe de base et le genre d’idéalisme que tu as montré soit récompensé et non utilisé contre toi. Malheureusement nous ne vivons pas dans ce monde. - C’est drôle… j’ai toujours pensé que le monde était ce que l’on en faisait. » (de 1:26:40 à 1:27:01, version française traduite de l’américain) Ce dialogue, caricatural, a lieu entre les personnages David Drumlin et Ellie Arroway. Or Drumlin est joué par Tom Skerritt, relativement âgé et les cheveux grisonnants, alors qu’Arroway est jouée par Jodie Foster, manifestement d’une génération plus jeune. Tout au long du film, la maîtrise et la sérénité de Drumlin tout comme la fougue et la jeunesse d’Arroway seront mises en évidence. Or, la représentation de l’adulte trouvera la mort alors que celle de la jeunesse se verra finalement récompensée bien qu’avec une étiquette d’incompréhension (à la fin du film devant la commission, nouvel icône de l’adulte). Ce thème de la difficulté des relations et du passage entre le monde adulte et celui de la jeunesse, à travers ce contact difficile entre une humanité à la jeune conscience et une civilisation extra-terrestre à la conscience adulte, est récurrente dans le film. Parce qu’en astronomie regarder loin c’est regarder vers le passé, l’auteur initial du roman, astronome chevronné et également instigateur du film, à su dégager un thème profondément humain dans un carcan scientifique -il faut juste regretter la contrainte américaine, dans le film, de trop appuyer sur l’affirmative divine- pour une oeuvre ultra-représentative de la scientification de la science-fiction : le sous-genre de la hard science. 2.3.2.2) Sous-genre et courants de la Science-fiction« Les définitions doivent être considérées comme des cartes: elles vous aident à explorer le terrain ; elle ne substituent pas l’exploration. » Brian Aldiss (1975) Pour structurer la science-fiction, je me servirai donc de ces univers-étalons afin de créer des sous-genres : la science-fiction classique, la science fantasy et la fiction spéculative. Ces sous-genres possèdent aux même d’autres sous-genres, que je qualifierai de ‘courant’ : anticipation, fantasy, post-apocalyptique, hard science, cyberpunk, uchronie et space opera, eux-même possédant également des courants : utopie, dystopie, etc. Plus on descendra dans les niveaux de structure, plus on abordera les récits dans un registre thématique et formel, plus proche d’une classification classique. Aujourd’hui, la structure de la science-fiction est ‘populairement’ présentée ainsi : Ici l'image du schémaCependant, sa structure est légèrement plus complexe comme le témoigne le schéma suivant :Ici l'image du schémaSuite à venir |

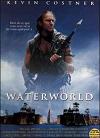
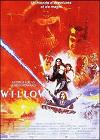

|