« La science-fiction c’est tout ce qui est publié sous le nom de science-fiction. » Norman Spinrad
|
Introduction 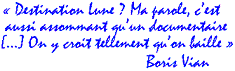
Voyage dans la lune (1902, Georges Méliès) est l’un des tous premiers films de science-fiction. Apollo 13 (1995, Ron Howard) est un film (de reconstitution) historique. L’un est film de fiction, l’autre est film de science. C’est entre les deux que se situe toute la puissance de la science-fiction. Cette comparaison, qui peut déjà initier à elle seule un très long débat, est de Forrest J. Ackerman (1). La science-fiction est cependant riche de ce genre de parallèles : faites manger des farines animales à des vaches et vous parlez d’agriculture, mais transposez en faisant manger de la farine humaine à des hommes et vous parlerez à nouveau de science-fiction (Soleil vert, 1973, Richard Fleischer). En 1997, Dolly peinait à sortir de son éprouvette qu’Andrew Niccol nous mettait en garde contre un génoïsme latent à la découverte du génome humain (Bienvenue à Gattaca, 1997, Andrew Niccol) (2). C’était alors de la science-fiction. En 2001, en France, une jurisprudence autorise des parents à attaquer leur médecin si leur enfant naît anormal. Pendant ce temps, aux Etats-Unis d'Amérique, des entreprises aux moyens colossaux tentent de noyer l’agriculture mondiale sous des produits issus d’une agriculture dite transgénique dont ils possèdent, bien entendu, tous les brevets ; brevets de gènes altérés de maïs ou autres céréales, les rendant plus resistantes et plus productives mais également stériles, obligeant l'agriculteur à réutiliser leurs produits. Dans l’émission L’Université de tous les Savoirs sur la chaîne télévisée Planète Future, un biophysicien dénonçait le cas d’une entreprise américaine qui renvoya plusieurs de ses employés suite à la découverte de fortes probabilités géniques à des maladies, après un test effectué sur des prises de sang obtenues lors d’un contrôle médical. 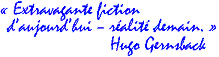
Inversement, dans un article de Physical Review Letters du 29 mars 1993, six physiciens théoriciens titrent leur article du mot ‘Téléportation’ (3). Ils déclarent avoir réussi la première téléportation d’un quark, plus petite particule connue. Jusqu’ici absurdité science-fictionesque maintenu de l’autre côté de la réalité par le célèbre principe d’incertitude d’Heisenberg, seule une poignée de scientifiques réagit. Les journaux télévisés n’en font qu’un petit sujet de quelques secondes. Le grand public, non scientifique, n’en fut absolument pas affecté : tous les jours depuis une vingtaine d’année l’équipage du Voyager se téléporte de monde en monde dans la série télévisée Star Trek. Cette étape de téléportation de particule n'est donc pas, pour la plupart des gens, une révolution scientifique et technique, mais uniquement une première étape logique vers une téléportation de masse. En Juillet 1969, l’équipage américain de la mission Apollo 11 allait marcher sur la lune, dans les traces de Tintin. Une demi-douzaine de personnes peuvent aujourd’hui tenir plus d’une année dans l’espace, à l’abri d’une station orbitale. N’importe qui peut faire jaillir du feu n’importe quand, d’un objet à peine aussi grand qu’un doigt. Science-fiction il y a dix, cent ou mille ans, ces petits miracles sont aujourd’hui bien réels et quotidiens. Si l’anticipation et la prédiction technique sont les formes les plus populaires de la science-fiction, elles ne limitent pas le genre à elles seules. John Clute, auteur de Science-Fiction : The Illustrated Encyclopedia, déclare que prédire l’avenir « n’est pas le but du jeu ». Pour lui, « La science-fiction apprend à ses lecteurs à regarder vers le futur ». La page sur les définitions de la SF nous a montré qu’il existe certainement autant de définitions et de conceptions de la science-fiction que d’acteurs de la SF. Et ce, même si l’on y constate l’existence de visions communes et de courants fédérateurs. Cependant, nous verrons que l'on peut reconnaître aujourd'hui à la SF cette notion de regard. Regard vers l'inconnu, regard vers la science, regard vers les autres, pour certains la SF est même directement issue d'un regard vers cette science magique peu à peu corrompue à mettre en avant les défauts de l'homme. Mais avant de se pencher plus en profondeur sur le phénomène de la science-fiction, posons nous la question : Qu’est-ce que la science-fiction ? Qu’est-ce que la science-fiction ? Une appellation tardive 
La première œuvre de science-fiction est unanimement reconnu comme étant Frankenstein ou le Prométhée Moderne, de Mary Shelley (4), qui paraît en 1818. Ce roman est alors qualifié de récit d’horreur romantique. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les frères Rosny, spécialistes du roman d’anticipation, parlent de romans scientifiques. A l’entrée du XXe siècle, Herbert G. Wells évoque la scientific romance et Maurice Renard, en 1909, les romans merveilleux-scientifiques. En 1924, Hugo Gernsback lance le terme de scientifiction juste après celui de roman parascientifique par Renard en 1923 qui évoquera ensuite le roman d’hypothèse en 1928. Gernsback l’emportera finalement un an plus tard, en 1929, avec science fiction (5) qui restera la dénomination officielle, malgré l’appellation speculative fiction émise pendant la guerre par Robert Heinlein et qui remporte aujourd'hui de nombreux suffrages. Le terme de science fiction n’apparaît que plus d’un siècle après la première représentation du genre qu’il veut définir. Ce tâtonnement à la recherche du qualificatif de ce nouveau courant est à l’image de la difficulté de le définir encore aujourd’hui. Cette expression, lancée par l’un des plus grands éditeurs du genre, a pour objectif premier -il faut bien l’avouer- la vente de ses propres histoires. Mais, avec le succès du magazine de Gernsback: Amazing Stories, « la science-fiction se vendait très bien et cela poussa les éditeurs à appeler SF n’importe quelle fiction, si bien que les œuvres authentiques du genre sont classées avec la magie noire, les westerns (où les cow-boys mutants ne chevauchent plus des chevaux mais des engins spatiaux) et un hybride […] appelé ‘sword and sorcery’ » (6). Bref, il suffisait de classifier le livre science fiction et la vente en était assurée. Comme il n’existait pas encore de gardien de l’appellation (7), n’importe qui pouvait alors faire n’importe quoi. 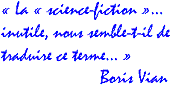
Se pose également un autre problème -purement français- de traduction anglo-française. Après la deuxième guerre mondiale la France était friande de tout ce qui venait d’Amérique et la sayence fikchen, bien que son essor provint au début du siècle par Vernes et Wells, respectivement français et anglais, suivit le jazz et le cinéma dans l’invasion culturelle américaine. Devant l’arrivée massive de cette littérature et de ce type de cinéma ainsi que le goût de l’américanisme de la part des français de cette époque, la traduction fut bâclée et littérale. Et si chacun des mots sont séparément très bien définis, leur association, paraissant contre-nature d’un premier abord, donne un sens différent de celui du terme anglais. Comme l’explique Serge Lehman dans sa préface d’Escales sur l’Horizon, fiction signifie roman en anglais, ou littérature romanesque, et non comme en français invention, imagination ou, plus précisément, affabulation. En outre, l'expression science fiction donne une valeur d’adjectif au terme de science et une valeur nominale à celui de fiction. Science fiction peut donc être traduit par récit romanesque à caractère scientifique. A l'inverse, le français science-fiction semble mettre les deux termes sur le même plan et même renverser le rapport, comme s’il s’agissait de science fictive, de fausse science ou des chimères de la science... Non seulement cette traduction approximative a entraîné une divergence entre science fictive et fiction de science, mais en plus le tiret ajouté tout aussi arbitrairement créé une confusion qui amène science et fiction « à un même niveau de lecture, nous donnant l’impression d’un genre bâtard qui tente de marier les deux dans une dérisoire tentative de synthèse. ». Le problème provient donc d’une réflexion à-posteriori de la traduction hâtive (fardeau supplémentaire pour les francophones) d’une dénomination purement commerciale. La solution actuelle consiste, pour chacun des auteurs de science-fiction, à donner sa propre définition. Une nouvelle dénomination pour ce genre est également recherchée par certains qui n’arrivent que rarement à se mettre d’accord, et la recherche de contours ou de contenus est généralement vaine. Recherche d'un cadre préalable à l'établissement d'une définition La plupart des gens ne considèrent la science-fiction que comme un genre bien défini tel le western, le policier ou l’aventure. Elle est cependant plus qu’une unique catégorie puisque, comme l’évoque René Barjavel (voir page des définitions), elle contient tous les genres. N’est-elle pas aventure lorsque l’on regarde un Star Wars (1977, Georges Lucas) qui vient du même Lucas qui officiait sur les Indiana Jones (1980, Steven Spielberg) ? N’est-elle pas western devant un Outland (1981, Peter Hyams) où le luxe à même été poussé jusqu’à engager des acteurs récurrents de western ? N’est-elle pas horreur avec un Alien (1979, Ridley Scott), épique avec un Dune (Franck Herbert), anticipation avec un Bienvenue à Gattacca (1997, Andrew Niccols), politique avec un 1984 (Georges Orwell), sportif avec Rule 18 (Clifford D. Simak) (8) ou romantique avec Les amants étrangers (Philip José Farmer) (9) ?… Ce genre est si multiple que toutes ses différentes formes constituent des sous-genres, eux-mêmes très riches et divers. Cependant, la base de chaque récit de science-fiction est motivée par une question ou un fait ancré dans le réel. Il semble que le terme science ait été accolé au terme ‘fiction’ pour ramener dans le réaliste (10) une histoire dont la forme peut s’évader loin dans l’imagination. Néanmoins, toutes ces histoires, si diverses soient-elles, sont reliés par un esprit science-fiction qu’aucun terme ne traduit. Dès lors, pour comprendre ce qu’est la science-fiction, intéressons nous d’abord à son sens premier : fiction scientifique. Il ne s’agit alors pas de fiction en tant que fantaisie mais en tant qu’hypothèse. « Nous pouvons trouver également une autre acception du terme : une 'fiction juridique', l'invention d'un fait hypothétique, pour en tirer des conséquences de droit. C'est, autrement dit, une conjecture, un travail de la raison qui élabore des cas-limites pour évaluer l'extension et la légitimité de la loi. » (11). Plus précisément, l’ imagination appelle la raison du lecteur à réfléchir sur un cas théorique afin d’éprouver la pertinence de règles. Science et fiction se rejoignent alors sans aucune antinomie dans la recherche d’hypothèses pour cette épreuve (12). La fiction à laquelle nous allons nous intéresser n’est pas raisonnement : puisque sa consistance principale est l’imagination et non la raison -bien qu’au service de cette dernière. Ainsi, certains citeront Démocrite qui « devant une colonne d'oiseaux migrateurs, se dit : « et si la matière était comme cette bande, constituée d'éléments plus petits ? Voilà qui expliquerait les changements d'états ! ». Il utilise ainsi les ressources de l'imagination pour proposer une hypothèse rationnelle, qui sera le fondement de toute la philosophie atomiste. Cela n'a rien d'une pure fantaisie, dans la mesure où l'intuition est guidée et motivée par la raison. » (13). C’est à dire que la forme fictive, soumise à l’imagination, est au service absolu d’un fond ancré dans cette optique de l’hypothèse. Par comparaison, une réflexion sur la forme d’un autre genre, comme le western par exemple, ne l’associe pas aussi profondément au fond du film, c’est à dire aux thèmes du genre. La forme classique du western montre un cow-boy sur un splendide étalon, coiffé de son magnifique chapeau, la main sur le revolver accroché à sa ceinture. Changez les thèmes du film; l’image du cow-boy restera immuable. Toute modification du fond n’en change pas pour autant la forme -puisque associée au genre. Parce que le western, comme la plupart des autres genres sont constitués d’un fond : de thèmes principaux récurrents, et d’une forme : une imagerie particulière (14) et des codes visuels récurrents (15). Or, pour la science-fiction, la forme est totalement au service du fond. C’est pourquoi la forme est si constamment changeante et si difficile à cataloguer, aiguisant la perversion de certains auteurs allant jusqu’à jouer avec la forme d’autres genres et les imiter. Voyageur spatial dans une histoire, fourmi dans une autre, carré découvrant la 3e dimension, enfant contemporain ou magicien médiéval, chaque personnage diffère. Chaque monde diffère (16). Le point sur lequel je voudrais donc appuyer est que le terme fiction employé dans l’expression science-fiction est un mot qui possède beaucoup de notions en français alors que seule une petite partie est utilisée dans ce cas -celle évoquant l’imagination- bien que ce soit une autre partie -celle évoquant la fantaisie- qui prédomine dans l’emploi courant du mot. Car, du coup, cette notion de fantaisie est malencontreusement rattaché à la science-fiction. C’est l’inconvénient du remplacement d’une traduction par une francisation. Ensuite, j’insiste également sur l’influence de cette fiction/imagination, sur la forme de tout récit de science-fiction, au service du fond, lui-même influencé par la science/raison. Je considère ce point primordial car il permet de bien cerner ce que, tout le long de mon discours, je qualifierai de science-fiction. 
J’évoquais précédemment qu’une autre définition est recherchée par certains auteurs ou théoriciens de la science-fiction. Malgré de nombreuses divergences, une expression revient assez régulièrement. Pour l’évoquer, il faut considérer une nouvelle expression : « En philosophie, on appelle spéculation théorique la recherche de la connaissance pure, c'est-à-dire l'élaboration de modèles rationnels parfaitement cohérents, mais sans souci marqué de coïncidence avec la réalité sensible ou actuelle. Introduire le terme de fiction spéculative, c'est donc tenter de ramener le terme à son sens originel, ou du moins de le décharger des a priori inconscients que l'expression ‘science-fiction’ véhicule à son insu. La fiction spéculative est donc une catégorie de fiction dans laquelle un fait, événement, objet, personnage ou décor est expressément spéculatif, c'est-à-dire dont l'existence est posée comme possible ou réelle en droit, même s'il n'a pas de réalité de fait. Cet élément spéculatif doit avoir un rôle indispensable dans la fiction, soit qu'il soit l'objet de toute la création, soit qu'il soit un préalable nécessaire à l'élaboration de l'intrigue. » Speculative fiction / Fiction spéculative La fiction spéculative, évoquée en premier par Robert A. Heinlein -l’un des plus grands auteurs de science-fiction- est sans doute actuellement l’expression la plus consensuelle, bien qu’elle ait toujours des détracteurs. Quoi qu’il en soit, la popularité de science-fiction rend aujourd’hui hors de question toute nouvelle appellation par l’industrie éditoriale ou cinématographique. Pire: une fois que le terme de fiction spéculative a été lancé, certains auteurs se sont appliqués à suivre cette ligne, puis à tenter d’y ramener la science-fiction ; un sous-genre était né. Plus précisément un nouveau tiroir de la commode science-fiction, permettant de mieux structurer celle-ci. Et pour les circonstances aggravantes, ce tiroir, telle la fantasy, le space opera ou le cyberpunk, eut à son tour la prétention de devenir commode. Il ne reste plus comme option que la vigilance lors de l’attribution du genre, entre science-fiction, fantastique, horreur, ou autres. Pour cela, nous ne pouvons que nous en remettre à la responsabilité d’éditeurs vis à vis d’un genre qu’ils considèrent encore comme mineur. La notion de fiction spéculative semble assez juste, mais une réserve doit cependant être émise sur la définition précédente (bien qu’étant l’une des plus justes, claires et concises). Le fait que chaque élément de la fiction soit spéculatif est une chose qui apparaît comme fondamentalement essentiel, mais que son existence soit « posée comme possible ou réelle en droit, même s’il n’a pas de réalité de fait » n’est pas justement formulé. Il est incontestable que la science-fiction pose réaliste des faits ou des éléments qui n’appartiennent pas à notre réalité. Mais la tournure de la phrase est litigieuse sur l’expression en droit. En effet : chacun de ces éléments qui n’appartiennent pas à notre réel est légitimé dans la fiction comme réaliste en droit grâce à des justifications scientifiques, techniques, pseudo-scientifiques ou pseudo-technique. Ainsi, la verticalité des passagers d’un vaisseau spatial justifié par un moteur d’antigravité, l’intelligence des robots par un cerveau positronique, etc. Si, par contre, cet élément n’est expliqué en aucune manière par quoi que ce soit, alors il s’agit de fantastique, et non plus de science-fiction. Quand une araignée géante attaque une ville, si la fiction ne fournit pas, de façon explicite ou implicite, la condition d’existence de l’animal au lecteur ou spectateur, il s’agit de fantastique (17). Si quelque mutation est évoquée, c’est de la science-fiction. Il faut néanmoins constater que l’âge, désormais vénérable de la science-fiction, permet parfois l’absence de justification sur des techniques et technologies déjà plusieurs fois employées dans des fictions précédentes. Comme tout montage parallèle, au cinéma, n’est plus expliqué par des cartons ‘pendant ce temps à tel endroit’, certaines justifications ne sont plus utiles car considérées comme science-fictionistiquement réels, acquis. De plus, une grande partie de la technologie inexistante dans la réalité utilisée dans la science-fiction n’est pas forcément justifiée puisqu’elle l’est implicitement par le fait même qu’elle soit une technologie et donc soutenue par une science plus pointue que celle que le lecteur/spectateur connaît. Par exemple, dans Star Wars (1977, Georges Lucas) la présence de moteurs à antigravité est justifiée par un simple dialogue entre deux personnages, mais le fonctionnement des pistolets lasers ne l’est pas. Ces moteurs sont un outil technologique, donc issus d’une science beaucoup plus avancée que la science actuelle qui ne permet pas la création de tels moteurs, et le lecteur/spectateur suppose que cette science (sous-entendue) légitime l’existence de pistolets lasers (18). Ce jeu entre la fiction et le lecteur/spectateur est en général l’un des attraits des plus grands fans du genre et autorise parfois une grande fantaisie. On pourrait alors proposer que le genre soit nommé : fiction spéculative à fondement scientifique, mais quelle justification d’existence n’appartient pas à la science ? Car le mot science couvre un territoire extrêmement large : non seulement les sciences dites exactes (mathématiques, physique, chimie), mais tout le spectre de la science : science humaines (histoire, sociologie, psychologie), science du vivant (biologie, écologie), économie, et même jusqu’à des sciences inventées dans la fiction (la psychohistoire dans Fondation d'Isaac Asimov). Donc, finalement, on entend par science l’ensemble des connaissances humaines ainsi que la démarche, le protocole d’obtention de ces connaissances. On en revient à la participation de la raison et de l’imaginaire. Le cliché habituel noie la science-fiction dans la technologie. Son absence y est pourtant totale dans des oeuvres comme Bilbo le hobbit (J.R.R. Tolkien) ou Le seigneur des anneaux (J.R.R. Tolkien) et plus généralement dans toutes les oeuvres de la fantasy. Pourtant, quand le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson adapte Le seigneur des anneaux pour le cinéma, il affirme suivre la ligne de Tolkien considérant le fameux anneau central des trois livres comme une allégorie de la machine. 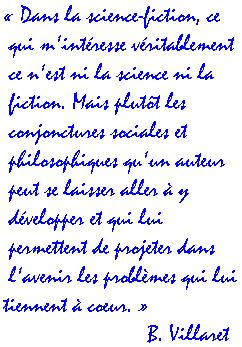
Explicite ou implicite, la science, omniprésente dans la science-fiction, est tout aussi omniprésente dans la réalité en tant que cristallisation de notre représentation du monde. Aujourd’hui, l’homme a réussi à presque tout observer et presque tout comprendre. L’univers, de la plus petite particule au cerveau humain -chose la plus complexe connue-, a été réduit en quelques équations. On est revenu à chaque conséquences de chaque cause et désormais ne nous reste que quatre ou cinq équations. Relativité générale, relativité restreinte, gravité et électromagnétisme sont les quatre composantes de ce qui est. Le dernier Graal de la physique est la théorie du tout, reliant ces quatre composantes en une seule explication de l' univers. Mais cette formule, une fois trouvée, nous donnera-t-elle le nom de Dieu ou l’âme de l’Homme ? La structure de l’univers ou la conceptualisation de l’univers par l’Homme ? L’objet ou l’image de l’objet ? Tout ce qui a été évoqué dans la partie précédente, quant à l’utilisation de la raison et de l' imagination pour la conception d’une fiction, pourrait être employé pour tout type de récit et pas seulement pour les récits de science-fiction. Par contre, le mécanisme par lequel j’affirmais que « l’imagination appelle la raison du lecteur à réfléchir sur un cas théorique afin d’éprouver la pertinence de règles » est propre à la science-fiction dans le sens où ces règles, c’est à dire la science, ne sont en fait que l’Homme et les règles qui distinguent l’Homme du Non-Homme. C’est pourquoi, par le véhicule de la science, l’homme, à travers la science-fiction, ne fait que s’intéresser à l’homme. Les règles, qu’éprouvent la science-fiction, ne sont que la définition de l’homme. Et l’avantage que possède la science-fiction sur les autres genres est qu’elle n’est pas soumise, comme eux, aux limites de forme d’un genre. En quelque sorte elle peut se lâcher. Nous verrons plus loin que la seule véritable limite de la SF est celle du récit, de l’intéressement du spectateur. Mais même si elle est soumise à ces codes de narration et d’intéressement, elle permet de les sublimer : comme le souligne Alexandre Hougron, « les plus gros blockbusters hollywoodiens ont toujours été, dans une immense majorité, des films de science-fiction […] Même s’il est difficile de définir ce qui donne le succès d’un film, la science-fiction est une valeur plus que sûre, au même titre que la comédie » (19). La première œuvre de science-fiction, Frankenstein ou le prométhée moderne, est inspiré d’un cauchemar de Mary Shelley. C’est le symbole d’une littérature ouverte sur l’imaginaire, donc l’inconscient (20). « …Par ses utopies, ses uchronies, ses anticipations, ou même sa fantaisie, chaque branche de la science-fiction permet de placer l'homme dans des situations inédites, déconnectées des déterminations réelles qui brouillent la compréhension de ses intentions. C'est nous-mêmes, ou une version différente de nous-mêmes, que nous cherchons dans la science-fiction » (21). C’est en tout cas ceci que j’appellerai science-fiction ou SF tout au long des lignes suivantes. Car c’est cette science-fiction, et non celle alourdie de clichés, que je vais chercher à étudier. |


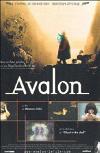


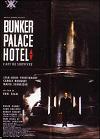
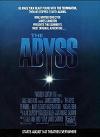
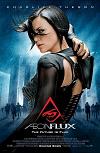
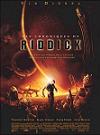







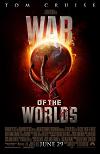
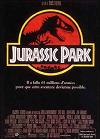




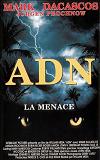



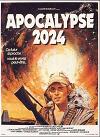
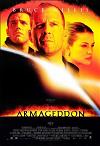
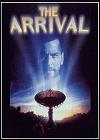
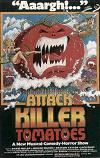



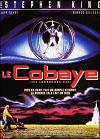

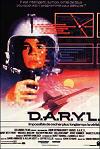

|